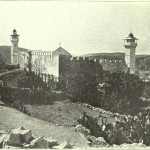http://www.ebaf.edu/wp-content/uploads/article_archeologie_benoit.pdf
Depuis le XIXe siècle, des chercheurs français se sont consacrés, à côté des savants d’autres pays, à l’étude archéologique de la Palestine. Qu’il suffise de rappeler les noms de Albert de Luynes (1802-1867), Léon de Laborde (1807-1869), Félicien de Saulcy (1807-1880), Victor Guérin (1821-1890), Melchior de Vogüé (1829-1916), Charles Clermont- Ganneau (1846-1923). À vrai dire, ils ne faisaient pas encore de fouilles proprement dites. Il s’agissait plutôt d’exploration de surface. D’autre part, ces géographes, ces archéologues ne résidaient pas dans le pays. Ils y faisaient des voyages de quelques semaines ou de quelques mois, venaient et repartaient.
Le premier établissement qui se fixa en permanence dans le pays fut l’École biblique des Pères dominicains, fondée en 1890. Son fondateur, le P. Marie-Joseph Lagrange, o.p., âgé de 35 ans, avait pour projet d’éclairer l’étude de la Bible par une connaissance scientifique du milieu humain où elle a été vécue, parlée, écrite. S’il y a une histoire du salut, il y a aussi une géographie du salut. La Bible a en Palestine un “Sitz im Leben” qui éclaire singulièrement son message. Dieu a parlé aux hommes d’un certain pays, avec les langues de leur temps, selon la culture de leur temps. Il s’agissait donc d’étudier la géographie de la Terre Sainte, l’histoire ancienne du Proche-Orient, les langues orientales, l’archéologie, l’épigraphie, etc. Rien n’était plus propice à cette étude qu’une résidence permanente en Palestine. Tel était le but que le Père Lagrange assignait à son œuvre, qu’il appelait intentionnellement “École pratique d’études bibliques“. Préparé par de sérieuses études en France, en Espagne et à l’université de Vienne, mais devant tout créer sur place, le P. Lagrange réussit rapidement à former une équipe de jeunes confrères dominicains, auxquels il répartit les tâches. Se consacrant lui-même davantage à l’exégèse et à la théologie bibliques, il lança le P. Hugues Vincent dans l’archéologie, le P. Félix Abel dans l’histoire et la géographie, le P. Antonin Jaussen dans la langue arabe, le P. Raphaël Savignac la langue syriaque et l’épigraphie, le P. Paul Dhorme dans la langue et la culture akkadiennes, ceci pour ne donner que les principaux noms.
Les cours commencèrent le 15 novembre 1890. Ils furent bientôt complétés par des publications : la Revue Biblique, publication trimestrielle commencée en 1892, les Études Bibliques, collection de commentaires ou autres ouvrages concernant la Bible, commencée en 1900.
Dés le début, l’enseignement et les publications s’accompagnèrent de la recherche archéologique qui les nourrissait. Les ressources modestes de la jeune institution ne permettaient pas encore d’entreprendre des fouilles. On commencerait par l’exploration de surface, était alors, comme elle est encore, très rémunératrice. À vrai dire, cependant, dès avant la naissance de l’École, des fouilles avaient été menées sur place par les premiers Pères du couvent dominicain pour dégager les ruines de la basilique érigée au milieu du ve siècle par l’impératrice Eudocie sur l’emplacement traditionnel du martyre de saint Étienne. Le couvent, qui devait bientôt abriter l’École, avait été établi à dessein, en 1882, sur ce lieu saint, et les fouilles retrouvèrent le plan de la basilique ruinée par les Perses en 614, ainsi que des mosaïques et des pièces d’architecture qui permettaient de restituer la figure du sanctuaire : une basilique à trois nefs d’une dimension assez notable pour l’époque, 40 m de long sur 20 m de large, précédée d’un atrium recouvrant de larges citernes et creusé de quelques tombes d’époque byzantine. Dès 1894, le P. Lagrange rendait compte, dans son premier ouvrage, des résultats de cette fouille : Saint Étienne et son sanctuaire à Jérusalem, Paris, Picard. Il décrivait en même temps quelques trouvailles annexes, notamment un hypogée situé dans le jardin, au sud de la basilique, que les parallèles offerts par des découvertes récentes en Judée invitent aujourd’hui à faire remonter au VIIe siècle avant J.-C.
À part cette fouille domestique, c’est donc à l’exploration de surface que l’École consacra ses premiers efforts. Des excursions auxquelles prenaient part professeurs et étudiants parcoururent systématiquement le pays, étudiant sa géographie, l’onomastique de ses montagnes et de ses vallées, relevant les toponymes qui rappellent les lieux bibliques, retraçant les routes anciennes et déchiffrant les bornes milliaires qui les jalonnent à l’époque romaine, ramassant les fragments d’inscriptions, d’architecture ou de sculpture laissés par les destructions des siècles passés. On ne circulait pas alors en auto comme aujourd’hui, mais à cheval ou à chameau. On voyait moins, mais on voyait mieux s’aimait à dire le P. Abel. Les courses en caravane, les veillées du soir près des tentes, en compagnie des guides arabes, sous le magnifique ciel d’Orient, procuraient un contact intime avec des coutumes ancestrales, des façons de vivre et de s’exprimer qui gardaient bien des affinités avec les coutumes et le langage de la Bible. Ces longues marches n’allaient pas sans fatigue, ni même sans danger. Pour passer du territoire d’une tribu bédouine à celui d’une autre tribu, il fallait traiter avec les cheikhs, louer des guides et des montures, payer des droits de passage. II arrivait même qu’on rencontrât des rezzous et essuyât des coups de feu. Mais cela ne manquait pas non plus de pittoresque et on apprenait beaucoup en se familiarisant ainsi avec les pays bibliques.

Raphaël Savignac et Antonin Jaussen décorés de la Légion d’Honneur, 1920 (collection École biblique et archéologique française de Jérusalem)
Il suffît de feuilleter la Revue Biblique pour y trouver dès ses premières années le récit des excursions dirigées par le P. Lagrange ou le P. Séjourné, et bientôt par les PP. Jaussen, Vincent, Savignac ou Abel : Masada (1894, 263-276), Transjordanie et sud Liban (1894, 615- 627), vallée du Jourdain (1895, 611-619), Hauran (1898, 596-611), Philistie (1900, 112-117), etc. Ces excursions rapportaient toujours quelques découvertes, notamment celles que le P. Lagrange et sa jeune équipe entreprirent à plusieurs reprises en deux sites fameux : le Sinaï et Pétra. Après un premier voyage au Sinaï en 1893, le P. Lagrange y retourna en 1896 et l’École devait y revenir plusieurs fois par la suite. Un tel voyage prenait facilement plus d’un mois : ainsi en 1896, départ de Suez le 15 février, retour à Jérusalem le 18 mars (RB 1896, 618-41; 1897, 107-30, 605-25). Sans être inconnus, les lieux étaient encore peu fréquentés, et l’on engrangeait une riche moisson en recueillant de nouveaux noms de montagnes ou de wadis, en redessinant des plans d’églises, de chapelles, de camps romains, en rectifiant la lecture d’inscriptions (voir à titre d’exemple RB 1898, 424-51). De plus, les données recueillies permettaient de renouveler la discussion de problèmes fameux, tels que le Sinaï biblique (RB 1899, 369-92) ou l’itinéraire de l’Exode (RB 1900, 63-86, 273-87, 443-49). Le site de Phounon (Nombres 32, 42) fut découvert par l’École (RB 1898, 112-15).
À Pétra, le P. Lagrange était chargé par l’Académie des inscriptions et belles lettres de Paris de retrouver une inscription nabatéenne jadis observée mais depuis lors perdue de vue. Grâce à la persévérance du P. Vincent, cette inscription fut repérée en octobre 1896 (RB 1897, 208-38), et le P. Lagrange put envoyer un estampage et une excellente copie au marquis Melchior de Vogüé, chargé des titres araméens du Corpus des inscriptions sémitiques. D’autres inscriptions de Pétra devaient suivre (RB 1898, 165-82, etc.) et bien d’autres venant d’autres lieux et en d’autres langues.
Car la recherche épigraphique fut toujours une préoccupation majeure des professeurs de l’École Biblique, notamment des PP. Savignac et Abel. D’autres savants collaboraient d’ailleurs avec eux en ce domaine, en particulier le P. J. Germer-Durand, assomptionniste, pour les inscriptions grecques. Dans la Table alphabétique de la Revue Biblique, 1892-1968, publiée par le Père J. Roussée en 1976, on ne trouve pas moins de 15 pages (p. 280-95) de références aux notes ou articles traitant d’inscriptions akkadiennes, arabes, araméennes, christo-palestiniennes, éthiopiennes, grecques, hébraïques, hiéroglyphiques, latines, lihyanites, nabatéennes, palmyréniennes, phéniciennes, proto-sinaïtiques, samaritaines, sud-arabiques, syriaques, thamoudéennes.
Les explorations itinérantes qui couvraient toute une région se fixaient aussi volontiers sur quelque site mal connu ou récemment découvert. C’est ainsi qu’en 1899, sur la demande de l’Académie des inscriptions et belles lettres, le P. Lagrange et sa jeune équipe précisèrent les limites et l’orientation du Tell Gézer (RB 1899, 422-27). En 1904, au cours d’une mission dans le Négeb confiée à l’École par la même Académie, les PP. Jaussen, Savignac et Vincent procédèrent à la première exploration approfondie du fameux site nabatéo-byzantin de Abdeh (RB 1904, 403-24; 1905, 74-89, 235-44).
Dès ses débuts, l’École s’intéressa aussi à la Transjordanie, et en particulier au village de Madaba, où des tribus arabes chrétiennes se sédentarisaient et où le développement de l’habitat mettait sans cesse au jour de nouvelles églises. Dans la RB de 1892, 617-44, le P. Séjourné rendait compte d’une première prospection archéologique et épigraphique, que bien d’autres devaient suivre (1897, 698-56, etc.), révélant peu à peu l’importance de l’école de mosaïque qui illustra cette ville à l’époque byzantine. En 1897, 165-84, 450-58, le P. Lagrange décrivait et analysait la fameuse carte géographique qui en est la perle.
Mais l’archéologie ne fait pas que ramasser des tessons, dégager des murs, restituer des monuments. Elle cherche à redécouvrir les anciennes cultures humaines sous leurs divers aspects, artistique, social, politique, religieux. Madaba était un endroit propice à l’étude des coutumes arabes, dont les traditions séculaires éclairent de si heureuse façon le Proche-Orient ancien, et avec lui le milieu biblique. Spécialisé dans la langue arabe, le P. Jaussen choisit donc ce lieu pour se livrer à cette enquête, d’où sont sortis plusieurs articles de la Revue Biblique (1901, 1902, 1903, 1906, 1910) et enfin un livre : Coutumes des Arabes au pays de Moab, Paris, Gabalda, 1908, réédité en 1948. Archéologie, épigraphie, ethnographie, ces trois domaines de recherche furent combinés dans l’exploration du nord de l’Arabie que le P. Jaussen et son compagnon le P. Savignac menèrent en 1907, I909, 1910-12, et dont les très riches résultats sont consignés dans un grand ouvrage en trois volumes sous le titre général de Mission archéologique en Arabie : I. De Jérusalem au Hedjaz. Médain-Saleh, Paris, Leroux, 1909. – II. El-`Ela. D’Hégra à Teima. Harrah de Tebouk, Paris, Geuthner, 1914, Texte et Atlas. – Supplément au vol. II : Coutumes des Fuqarâ, Paris, Geuthner, 1920. – III. Les châteaux arabes de Qeseir `Amra, Harâneh et Tûba, Paris, Geuthner, 1922, Texte et Atlas. Cette mission, subventionnée par la “Société française des fouilles archéologiques”, et aussi plus tard par l’Académie des inscriptions et belles lettres, requit des explorateurs courage et endurance. Incommodité des moyens de transport (le chemin de fer du Hedjaz, alors en construction ! et chameaux pas toujours disponibles), sévérité du climat (températures sous la tente atteignant des maxima de 42 degrés centigrades), concours souvent déficient des Autorités responsables, hostilité des Bédouins ou empêchements que créaient leurs guerres intestines, tout cela se liguait pour entraver la recherche. Triomphant des obstacles par leur ténacité, les deux explorateurs rapportèrent une riche moisson d’informations nouvelles : relevés topographiques détaillés de leurs itinéraires, descriptions de monuments et copies de nombreuses inscriptions dans la grande nécropole nabatéenne de Médain-Saleh (ancienne Hégra), inscriptions minéennes de EI-Ela (ancienne Dedan) et inscriptions lihyanites du site voisin Hereibeh, graffites thamoudéens des environs de Teima et de Tebouk, nouvelles enquêtes sur les coutumes bédouines, enfin dans le désert au sud-est d’Amman examen renouvelé de trois châteaux omeyyades, voilà très brièvement les principaux fruits de cette valeureuse expédition.
Les explorations de pionniers qui viennent d’être évoquées furent suivies de bien d’autres et sont restées une tradition de l’École. Parmi les plus importantes qui ont précédé la première guerre mondiale, il faut encore mentionner celles du P. Abel : Une croisière autour de la mer Morte en quatre articles de la RB 1909-1910, rassemblés en un volume (Paris, Gabalda, 1911) ; Exploration de la vallée du Jourdain, quatre articles de la RB 1910-1913 ; Le littoral palestinien et ses ports (RB 1914). En juillet 1914, les PP. Jaussen et Savignac se remettaient en route, cette fois pour une mission épigraphique à Palmyre, à eux confiée par l’Académie des inscriptions et belles lettres (RB 1920, pp. 359-419).
Si l’École ne pouvait pas encore entreprendre de grandes fouilles, elle s’intéressait évidemment à celles que menaient des institutions plus fortunées. L’un ou l’autre des professeurs et surtout le P. Vincent entretenaient des relations suivies avec les archéologues, fréquentaient leurs chantiers, et rendaient compte de leurs travaux dans des Chroniques de la Revue Biblique. Gézer et autres tells de la Shéphélah, Jéricho, Samarie, Ta`annak, Megiddo, etc., autant de sites dont l’investigation archéologique était soigneusement suivie et rapportée. De ces nombreuses analyses le P. Vincent dégagea bientôt une synthèse dans l’ouvrage Canaan d’après l’exploration récente, Paris, Gabalda, 1907.
La fréquentation des archéologues était ordinairement des plus amicales et débouchait parfois sur une véritable collaboration, où l’on mettait en commun expériences et suggestions. Un cas particulier fut celui des fouilles de la mission Parker à Jérusalem en 1909-11, sur la pente orientale de l’Ophel et dans le canal de Siloé, à laquelle l’École fut si étroitement mêlée que les explorateurs anglais demandèrent au P. Vincent d’en rédiger le rapport final : Jérusalem sous terre. Les récentes fouilles d’Ophel, Londres, Horace Cox, 1911.
La Ville sainte, où résidait l’École, restait évidemment le lieu privilégié de la recherche. Dès le premier numéro de la Revue Biblique (1892, 17-38) le P. Lagrange prit résolument parti pour la localisation de la Sion jébuséenne et davidique sur la petite colline orientale, dite communément “Ophel”, entre le Cédron et le Tyropoeon, et non pas sur la colline occidentale où une tradition séculaire prétendait la trouver, à la suite d’un transfert qui s’est produit à l’époque chrétienne. Cette lucide prise de position eut une influence décisive pour établir une identification qui a été bientôt, et demeure, acceptée par tous les savants. Bien d’autres articles suivirent, qui traitèrent des diverses enceintes, de trouvailles occasionnelles, etc.
Bientôt le projet fut conçu de réaliser une vaste enquête sur l’histoire de la ville et de ses monuments. Le P. Vincent se chargerait de l’archéologie, et le P. Abel de l’histoire. En ce qui concerne l’archéologie, il n’était pas encore question de fouilles, alors généralement impossibles, mais il s’agissait d’examiner et d’interpréter avec toute l’exactitude possible les vestiges du passé, remparts et portes, piscines, monuments civils, sanctuaires. La susceptibilité et souvent l’intolérance des habitants, clercs et laïcs, soulevaient maintes difficultés, et il fallut toute la ténacité du P. Vincent pour en avoir raison. Quant à l’histoire et aux textes qui la rapportent, nul n’était plus qualifié pour en traiter que le P. Abel, dont la vaste érudition et l’étonnante mémoire étaient contrôlées par un esprit critique fin et exigeant. De cette collaboration devait résulter une grande œuvre qui, en dépit des corrections requises par le progrès des découvertes, demeure dans sa substance un classique indispensable.
On commença naturellement par les époques anciennes et dès 1912 paraissait le premier fascicule du premier tome : Jérusalem Antique. Topographie, Paris, Gabalda, Texte et Atlas. Mais la première guerre mondiale interrompit bientôt cette publication, qui ne devait être reprise que bien plus tard, en 1954-56. Dès maintenant, d’ailleurs les PP. Vincent et Abel pouvaient présenter un autre résultat de leur fructueuse collaboration. Des vérifications d’architecture dans la basilique de Bethléem, entreprises en 1911 sur la demande du marquis M. de Vogüé, avaient procuré assez d’observations neuves et importantes pour aboutir à une interprétation renouvelée de l’ensemble du monument, et devenir l’objet d’une substantielle monographie : Bethléem. Le sanctuaire de la Nativité, Paris, Gabalda, 1914.
La guerre de 1914-18 interrompit toute cette activité. L’Empire turc s’étant rangé aux cotés de l’Allemagne, tous les Pères français durent quitter Jérusalem, laissant la maison à la garde, très efficace, de Frères dominicains suisses. D’ailleurs, à l’exception du P. Lagrange qui put regagner Paris, tous étaient d’âge à être mobilisés et servirent à divers titres dans les armées de terre et dans la marine. Le pli de l’archéologie était si bien pris chez eux que le P. Savignac, par exemple, profita de son enrôlement sur un bateau dans la Méditerranée pour explorer les îles de Rouad (RB 1916, 565-92) et de Castellorizo (RB 1917, 52036).
Le P. Dhorme, en 1915, mobilisé dans la presqu’î1e de Gallipoli sur le Détroit des Dardanelles, se voyait confier par son chef d’état-major, la reconnaissance du site d’Éléonte d’où Alexandre se serait embarqué. Une fouille de sauvetage eut lieu sous sa direction, et les trouvailles (cinq beaux sarcophages, des céramiques grecques, des bijoux) furent expédiées à Paris par les soins de l’armée française (cf. RB 1915, 573-575).
Rentrés au logis en 1918, ils reprirent leurs travaux selon le programme et les méthodes de la période précédente, déjà bien éprouvés par l’expérience. L’archéologie restait une pièce maîtresse de leurs préoccupations. D’ailleurs, depuis 1920, l’École avait été rattachée à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, ce qui avait complété son titre d’École biblique par les mots et archéologique française. Son directeur, nommé par le Maître général des dominicains, était approuvé par l’Académie, et celle-ci envoyait des pensionnaires qui, profitant des activités et de la bibliothèque de l’École, composaient un Mémoire remis à l’Académie. Ceci valut à l’École l’honneur de collaborer à la formation de nombreux archéologues français du Proche-Orient.
Le projet du grand ouvrage sur Jérusalem fut repris, mais sous un angle nouveau. Comme nous l’avons dit, l’étude de la ville de l’Ancien Testament ne devait être publiée par le P. Vincent qu’en 1954-56. Pour le moment, c’est vers la ville de l’ère chrétienne que se tournèrent les efforts des PP. Vincent et Abel. Tous les sanctuaires, à commencer par le Saint- Sépulcre, furent étudiés dans leur architecture comme dans leur histoire, à travers les siècles jusqu’à l’époque moderne, et il en résulta un tome ii intitulé Jérusalem Nouvelle, en quatre fascicules : I et II. Aelia Capitolina, le Saint-Sépulcre et le mont des Oliviers. III. La Sainte-Sion et les sanctuaires de second ordre. IV. Sainte-Anne et les sanctuaires hors de la ville. Histoire monumentale de Jérusalem Nouvelle, Paris, Gabalda, 1914, 1922 et 1926.
Vers la même époque paraissait un autre grand ouvrage, consacré lui au fameux Harâm d’Hébron, estimé à juste titre d’origine hérodienne et recouvrant la grotte de Macpéla, sépulture des patriarches d’après la tradition biblique. Dés le début de l’occupation britannique, l’autorité mandataire avait décidé de promouvoir un examen archéologique sérieux de ce monument célèbre, jusqu’alors pratiquement inaccessible. L’entreprise fut confiée au capitaine Mackay, qui voulut bien associer le P. Vincent à son enquête. Une semaine de travail minutieux, confirmé par quelques contrôles ultérieurs, permit de dresser un relevé complet du monument, à l’exception bien entendu de la caverne, toujours résolument interdite. Les résultats de cette enquête, menée en 1920, furent publiés en un beau volume in-folio sous le titre : Hébron. Le Haram el-Khalil. Sépulture des Patriarches, Paris, Leroux, 1923, où le capitaine Mackay et le P. Vincent présentaient la partie archéologique, avec descriptions détaillées, plans et photographies, tandis que le P. Abel rédigeait la partie historique, des origines à nos jours. Voir encore l’article du P. Vincent dans la RB 1920, pp. 507-39.
Les explorations, avec relevés topographiques et archéologiques, reprirent aussi sans tarder, facilitées par un progrès rapide du réseau des routes. L’ère du chameau s’effaçait peu à peu devant celle de l’automobile. Le P. Savignac étudia la région de Aïn Qedeis en 1921 (RB 1922, pp. 55-81) et encore en 1937, en compagnie des PP. de Vaux et Benoit (RB 1938, 89-100). Lors d’une expédition en Transjordanie méridionale, en 1935 (RB 1936, 235-62), il avait la bonne fortune de pouvoir visiter et photographier le lieu saint musulman, farouchement interdit, du Djebel Haroun près de Pétra.
De 1923 à 1926 le P. Abel publia dans la Revue Biblique six articles sur “la topographie des campagnes maccabéennes”, en 1928 deux articles sur “un circuit en Transjordanie”, en 1929 des “Notes complémentaires sur la mer Morte”, et en 1931-32 quatre articles sur une “exploration du sud-est de la vallée du Jourdain”. En 1935, il réussissait à identifier le site biblique de Tappouah (RB 1936, 103-12).
Comme auparavant, l’exploration se limitait parfois à un monument particulier : l’église du Puits de la Samaritaine (expertise de 1919, publiée dans la RB 1958, 547-67), l’église-mosquée de Néby Samouil (RB 1922, 360-402 ; cf. déjà 1912, 267-79), les monuments de Qoubeibeh (relevés de 1896-1902 publiés dans la RB 1931, 72-80).
De nouveaux membres de l’École prirent bientôt la relève des anciens. Ainsi le Père Tonneau explorant à nouveau le Négeb (RB 1926, 583-604 ; 1927, 93-98) et le pays de Samson (RB 1929, 421-31) ; le P. Barrois participant aux travaux d’une expédition américaine dans le désert minier de Serabit el-Khadim, au Sinaï (RB 1930, 578-98) ; et un peu plus tard, les PP. de Vaux et Benoit explorant la région de Salt, en Transjordanie (RB 1938, 398-425 ; 1941, 16-47), puis la montagne d’Ephraïm (RB 1946, 260-74).
Sous le régime du mandat britannique les fouilles de diverses institutions étrangères reprirent de plus belle et, comme par le passé, l’École Biblique les suivit attentivement. On en trouve de nombreux comptes rendus dans la Revue Biblique. Ainsi Ascalon (1921), Beisan (1922-27), el-Hammam-Tibériade (1921-22), Tell el-Foul (1923), D6r (1924), Beit-Mirsim (1927-29), Ramet el-Khalîl (1927-30), Tell en-Nasbeh (1927), Silo (1927), Sichem (1927), Tell Djemmeh (1929), Tell Far’a du sud (1929), Beth Shemesh (1929), Tell Djerisheh (1929), Beit Alpha (1930), Jéricho (1931-39), Tell Abou Hawam (1935), la basilique de Bethléem (1936-37), et-Tell (1937), Tell ed-Douweir (1939), sans parler de fouilles françaises dont il sera question plus loin.
Tout en s’intéressant ainsi aux entreprises d’institutions amies, anglaise, américaine, allemande, et en collaborant volontiers avec elles, l’école française se souciait d’avoir un jour ses propres fouilles. Cela commença sur une échelle modeste, un peu au hasard des circonstances. En septembre 1918, un obus d’une batterie germano-turque fit apparaître des fragments d’une mosaïque près de ’Aïn Douq, au nord-ouest de Jéricho. Un régiment australien de passage dégagea davantage ce pavement. Dès que la paix fut revenue, la puissance mandataire se préoccupa de sauver ce monument déjà en péril. Deux officiers anglais, le capitaine Engelbach et le lieutenant Mackay, chargés de cette besogne, demandèrent à l’École de les assister. Commencé en juin 1919, le déblaiement se poursuivit en 1921. II produisit le plan d’une synagogue avec inscriptions hébréo-araméennes et un beau pavement mosaïque comportant entre autres ornements un zodiaque central, chose alors nouvelle. Ces résultats furent publiés dans la RB 1919, 532-63 ; 1921, 442-443 ; 579-601 ; 1961, 163-77.
La découverte fortuite d’un hypogée antique à Naplouse, sur la pente du mont Ebal, occasionna un autre dégagement par l’École, en 1919 (RB 1920, 126-35) et en 1921 (RB 1922, 89-99). Le site avait été saccagé par l’armée occupante, ainsi que par des fouilleurs clandestins. On étudia et interpréta ce qui subsistait après ces ravages : une sépulture judéo- samaritaine du début de notre ère, embellie vers 135-150 ap. J.-C., livrant encore deux beaux sarcophages intacts, les fragments de deux autres, et les menus objets, lampes, monnaies, débris de poterie ou de verre, qui avaient échappé au pillage.
Peu après, en décembre 1921 (RB 1922, 259-81) puis en mai 1924 (RB 1924, 583-604), sur la demande du Service des antiquités britannique, l’École mena à Beit Djebrin une fouille qui découvrit une belle villa d’époque romaine, commencée au début du IIIe siècle de notre ère, et bientôt enrichie d’une somptueuse mosaïque (figures des saisons, fauves, scènes de chasse) et de deux galeries pavées de marqueteries de marbre. Détruite au IVe siècle, peut-être par le tremblement de terre de 362, cette riche villa devint vers 500 ap. J.-C. l’habitat de l’évêque ( ?) Obodien, qui y établit une chapelle, pavée elle-même d’une jolie “mosaïque aux oiseaux” avec inscription dédicatoire. Après une nouvelle destruction en 634 (invasion arabe), l’édifice fut restauré vers 638 en une église modeste. Le rehaussement du niveau préserva heureusement les niveaux romain et byzantin. Il est dommage que ceux-ci, remis en valeur par la fouille et soigneusement protégés, aient été ensuite irrémédiablement saccagés par les souliers maladroits de soldats, durant la deuxième guerre mondiale. À l’occasion de cette fouille, trois tombeaux du site voisin de Tel Sandahannah (Marisa), du genre de ceux qu’ont publiés en 1905 Peters et Thiersch, furent étudiés (ou réétudié pour l’un d’eux) avec déchiffrement des inscriptions.
Signalons encore, en cette même année 1924, le premier déblaiement d’une église byzantine, avec mosaïque et tombeau d’un certain Claudianos, à Kh. Hebeileh, 2 km au s./s.- o. de Beit Zekâria (RB 1925, 279-82 ; cf. 1939, 87-90).
Une fouille plus considérable devait bientôt suivre, fin 1924 et printemps 1925, portant cette fois sur la basilique d’Amwâs. Un premier relevé précis de ce qui était visible de ce monument après les déblaiements du capitaine Guillemot (1876-1882) avait déjà été publié par P. Vincent dans la RB 1903, 575-94. Mais une fouille renouvelée et approfondie s’imposait. Elle put avoir lieu en 1924-25, avec l’accord du Service des antiquités britannique. Une première présentation succincte des résultats en fut donnée dans la RB 1926, 117-21 ; mais la publication intégrale de l’expertise et de son interprétation fut l’objet d’un gros volume, richement illustré : Emmaüs. Sa basilique et son histoire, Paris, Leroux, 1932, où les Pères Vincent et Abel collaboraient comme à l’accoutumée, l’un pour l’archéologie, l’autre pour l’histoire. Tandis que le P. Abel concluait de son enquête historique que Amwâs représente bien l’Emmaüs évangélique – opinion qui reste discutable –, le P. Vincent croyait pouvoir affirmer que la première basilique avait été construite dans le premier quart du DIe siècle, sur l’emplacement d’une villa de l’époque des Sévères. Cette thèse hardie fut attaquée par quelques archéologues. Une fouille complémentaire, en 1935, donna au P. Vincent l’occasion de défendre sa position (RB 1936, 403-15), défense qu’il reprit une dernière fois dans un article de la RB 1948, 348-75. Une nouvelle inscription a été publiée par Y. Blomme dans la RB 1980, 406-7.
Ces investigations archéologiques en développement s’étendirent aussi aux pays voisins. En 1926, l’Académie des inscriptions et belles-lettres chargeait l’École archéologique française de Jérusalem d’entreprendre des recherches méthodiques sur le Tell de Neirab, à 7 km au sud-est d’Alep. Ce site avait été rendu célèbre par la découverte, en 1891, de deux stèles araméennes. Deux campagnes de fouilles furent menées en automne de 1926 et 1927, la première dirigée par les PP. Carrière et Barrois, la seconde par les PP. Abel et Barrois, assistés chaque fois, entre autres, par le Pasteur André Parrot, alors pensionnaire de l’Académie à l’École, qui devait être plus tard le fouilleur de Mari et devenir Directeur général du Musée du Louvre. Les résultats furent publiés dans la revue Syria, VIII, 1927, 126-42 ; 201-15 ; IX, 1928, 187-206, 303-19, et dans la RB 1927, 257-65 ; 1928, 263-75. Une « dévastation radicale… dès un âge reculé » n’ayant laissé que des ruines incohérentes de l’agglomération primitive, et surtout la présence d’un village sur l’emplacement principal du site, ne permirent que des résultats limités, et néanmoins importants. L’exploration d’une nécropole de la fin de l’empire néo-babylonien et des premiers temps de l’époque perse attesta la présence, au VIIe siècle av. J.-C., d’une population araméenne dont la culture trahit de fortes influences babyloniennes, et aussi hittites. On recueillit d’intéressantes informations sur les anciens modes de sépulture, ainsi que de nombreux objets, jarres funéraires, figurines, cachets, scarabées, parures, pointes de flèches, etc., et un lot de 25 tablettes cunéiformes qui sont pour la plupart des contrats (publiées par P. Dhorme dans la Revue d’Assyriologie, XXV, 1928, 53-82).
Au printemps 1932, le P. Savignac était invité par M. G. Horsfield, directeur du Service des antiquités de Transjordanie, à participer à l’étude d’un lieu de culte nabatéen que celui-ci venait de découvrir dans la région du Djebel er-Ramm, au nord-est de Aqabah. Au pied d’un imposant massif rocheux culminant à 1 750 m, de nombreuses sources ont permis jadis l’établissement d’un village nabatéen ; et l’une d’entre elles, ’Aïn Shellâleh, blottie dans un petit wady très pittoresque, a été entourée d’un sanctuaire rupestre : bétyles avec inscriptions grecques et nabatéennes portant les noms de Allat de Bosra, el-’Uzzâ, “le Seigneur du Temple” ; restes d’un monument dédié au roi nabatéen Rabbel II. Cet ensemble fut analysé et déchiffré en 1932 (RB 1932, 581-97 ; 1933, 405-22), puis en 1934, avec mission de l’Académie des inscriptions et belles-lettres et collaboration du P. Barrois (RB 1934, 572- 91). Cette dernière exploration porta en outre sur un petit temple nabatéen situé sur une colline au centre de la plaine, à l’emplacement de l’ancien village, que la fouille dégagea du sable, établissant son plan périptère et déchiffrant ses inscriptions et graffites grecs et nabatéens, ainsi qu’une inscription latine (RB 1935, 245-278). Notons que cette fouille n’avait pu être complète, et qu’une expédition ultérieure de la British School of Archaeology de Jérusalem, dirigée par Diana Kirkbride, permit d’en réviser et compléter les conclusions (RB 1960, 65-92), y distinguant mieux diverses périodes qui s’échelonnent de la fin du Ier siècle ap. J.-C. au IVe siècle ap. J.-C.
À Mâ`in, gros village à 8 km au sud-ouest de Madaba, la découverte fortuite d’une mosaïque amena les Pères Savignac et de Vaux à pratiquer en octobre 1937, avec l’autorisation du Service des antiquités de Transjordanie, le dégagement de ce qui fut une église byzantine (RB 1938, 227-58). L’édifice est presque totalement détruit, mais ce qui reste de son pavement en mosaïque est intéressant, notamment par une bordure topographique qui encadre sa partie centrale : des villes de Palestine et de Transjordanie y sont représentées par des églises, dont le dessin maladroit et quelque peu conventionnel semble bien vouloir évoquer des monuments réels. Chaque monument est accompagné du nom de la ville qu’il représente. On en lit encore onze aujourd’hui : Nicopolis, (Geôrgiou- ou Eleuthéro]polis, Ascalon, Maïoumas, [Ga]za, Od[roh], [Karak-mo]uba, Aréopolis, Gadoron, Belemounim. Posée dans le dernier quart du VIe ou la première moitié du VIIe siècle, cette mosaïque a vu ses figures animées détruites par des iconoclastes, sans doute sous Omar II vers l’an 717, et fut restaurée en 719/20 comme l’indique une inscription. Cette exploration procura en outre quelques « glanures archéologiques à Mâ’in » (RB 1939, 78-86).
La deuxième guerre mondiale vint à nouveau troubler les activités de l’École, mais la Palestine étant cette fois dans le camp des Alliés occidentaux, les Pères qui pouvaient être mobilisés le furent sur place. C’est ainsi que, tout en travaillant au Consulat général de France à Jérusalem, le P. de Vaux put entreprendre en 1944, grâce à une subvention du Gouvernement provisoire de la République Française une exploration archéologique de l’église d’Abu Gosh, propriété de la France. Il publia les résultats de ses recherches dans un article de la RB 1946, 125-34, et ultérieurement dans un volume où il s’associait le Père A.-M. Stève, son collaborateur-dessinateur : Fouilles à Qaryet el-’Enab, Abu Gosh, Palestine, paru à Paris, chez Gabalda en 1950. Ses conclusions établissaient une chronologie de l’évolution du site : 1) aux IIe-IIIe siècles de notre ère, un réservoir captant les eaux d’une source et alimentant la mutatio, sans doute au neuvième mille, d’une route romaine allant de Jérusalem à Nicopolis ; 2) un caravansérail arabe construit au IXe siècle, desservant la même ancienne voie, devenue la route des Califes de Jérusalem à Ramleh, leur nouvelle capitale ; 3) une reprise de ce caravansérail par les Hospitaliers, au XIIe siècle, avec construction d’une église au- dessus de l’ancien réservoir transformé en crypte, le site étant devenu pour les Croisés la “Fontaine des Émaux”, par identification avec l’Emmaüs évangélique ; 4) après la victoire de Saladin et la ruine partielle du monument, une restauration mamelouke du caravansérail, qui fut définitivement abandonné à la fin du XVe siècle. Sans pouvoir être complète, cette fouille bien menée révéla l’histoire d’un site important, et apporte en particulier des informations nouvelles sur la céramique musulmane des Xe-XIe siècles.
Peu après, en 1945 et 1946, le P. de Vaux assisté du P. Stève et d’autres membres de l’École, entreprit, avec l’autorisation du Département des antiquités britannique, une fouille à ’Ain el-Ma’moudiyeh, près du village de Taffûh, à 8 km à l’ouest de Hébron. Le docteur Clemens Kopp, bon connaisseur des anciens pèlerinages, avait identifié en ce lieu, par l’examen des textes, un site où les pèlerins du Moyen Âge vénéraient le désert où Jean-Baptiste baptisait, lieu où ils mentionnaient une source et une église. Le nom même de Ma’moudiyeh appuyait cette identification (RB 1946, 547-58). De fait, la fouille menée par l’École sur le conseil du docteur Kopp a pleinement confirmé sa découverte (ibid. 559-75). Elle a dégagé une petite chapelle dont le caractère baptismal est clairement indiqué par la grande vasque qui en occupe le milieu, et où un tunnel amène l’eau de la source voisine. Un monastère se trouvait aux environs pour accueillir les pèlerins ; ses édifices sont très détruits, mais il en reste un grand linteau avec inscription grecque. Sur la colline qui domine chapelle et monastère-hospice, on voit les ruines d’un fortin qui devait protéger ce lieu de pèlerinage. Sa porte se dresse encore, surmontée d’un linteau portant une croix cantonnée des lettres A, W, IC XC (inscription qui est devenue l’emblème de la « Bible de Jérusalem ») ; la grande meule qui la fermait est toujours là, avec la rainure où elle roulait. Cet ensemble remonte probablement à l’époque de l’empereur Justinien ; la tradition est restée vivante jusqu’au Moyen Âge, comme en témoignent les pèlerins, et elle est encore dans la mémoire des habitants actuels de la région.
Ces diverses fouilles relativement modestes préparaient peu à peu l’École à entreprendre des fouilles de plus grande envergure. Au P. de Vaux devenu directeur de l’École après la seconde guerre mondiale, revint de mettre un tel projet à exécution, en recourant à l’appui de l’Académie des inscriptions et belles-lettres et au soutien financier de la Commission des fouilles du gouvernement français. Il choisit le site de Tell el-Fâr’ah (du Nord, à distinguer du site du même nom, dans le sud de la Palestine, fouillé par Sir Flinders Petrie). Ce tell, situé à 11 km au nord-est de Naplouse, se recommandait par sa remarquable situation : entre deux sources, dont la plus importante, `Aïn Fâr`ah, donne naissance à un cours d’eau pérenne qui descend par le wady Fâr`ah vers la vallée du Jourdain, où il aboutit près du gué de Damieh, en face du wady Zerka, le Yabboq de la Bible, lui aussi parcouru par un ruisseau permanent. Ces deux voies d’eau constituaient pour les anciens pasteurs nomades une excellente route d’accès de Transjordanie en Canaan, et il n’est pas douteux que les patriarches bibliques en usèrent pour entrer dans la Terre promise, comme le montre la Bible quand elle mentionne comme première étape cananéenne d’Abraham la ville de Sichem (Gn 12, 5-6), située peu au sud de ’Aïn Fâr`ah. Ce grand tell, long de 600 m et large de 300 m, situé au confluent du wady Fâr`ah descendant vers l’est et de deux autres vallées montant vers le nord et vers le sud, promettait à l’exploration archéologique d’importants résultats. Le P. de Vaux, assisté d’abord du P. Stève, puis des PP. Boismard, Coüasnon, Rousée et d’autres professeurs et étudiants de l’École, consacra à cette exploration neuf campagnes de fouilles, de 1946 à 1960, dont il rendit compte dans des rapports très nourris de la Revue Biblique, de 1947 à 1962.
Il y découvrit une occupation remontant à l’époque néolithique et se prolongeant jusqu’à la ruine du royaume d’Israël, en 723-721 av. J.-C., avec une interruption entre la fin de l’Ancien Bronze et le Moyen Bronze II (environ 2600-1800 av. J.-C.). Après avoir attaqué le tell dans sa région nord, près de la source `Ain Fâr`ah, en un endroit qui pouvait faire espérer une porte de la ville, il porta son principal effort sur la région ouest qui avait une allure d’ “acropole” et qui, de fait, livra d’importants résultats. Nous ne pouvons ici que les résumer à grands traits.
Après les « fonds de cabanes » caractéristiques du néolithique et du chalcolithique moyen (ou inférieur) et supérieur, on a constaté cinq niveaux de l’Ancien Bronze, qui fut une époque florissante de la ville, encore qu’on y constate une couche de grave destruction par incendie. À cette époque appartient un rempart qui commence et finit avec elle, et dont l’évolution compliquée a pu être analysée en détail. À y relever une très belle porte de ville, flanquée de deux tours massives, en briques crues sur assises de pierre, dont l’évolution va, comme celle du rempart, du début à la fin de l’Ancien Bronze. Elle n’a pas son pareil en Palestine. À noter aussi, de cette période AB, un sanctuaire plusieurs fois remanié.
Après la longue interruption déjà mentionnée, la réoccupation de la ville au Moyen Bronze ii présente un nouveau rempart édifié sur les ruines de l’ancien, avec une porte de ville à « tenaille simple », située à quelque distance au nord de la porte de l’AB. Un égout sortait de la ville en passant sous cette porte. La fouille a révélé aussi, à cette époque du MB II, entre 1800 et 1600 av. J.-C., un sanctuaire souterrain, en relation probable avec un édifice supérieur disparu, qui évoque un culte de caractère chtonien. Les niveaux du Moyen et du Récent Bronze ont été, en fait, très détruits. On peut toutefois relever dans ce dernier niveau une large construction qui a pu être un temple.
L’époque du Fer a livré de nombreuses maisons israélites dont les plans sont bien clairs ; on y remarque le voisinage de maisons riches et de maisons pauvres qui fait songer aux reproches des prophètes (Am 5, 11 ; Is 9, 8-9). La porte de ville du MB restait en usage, un peu remaniée. Devant elle, à l’intérieur, on a trouvé une pierre haute de 1,80 m, qui peut être une massebah, et à côté d’elle un bassin à ablutions : sans doute une installation cultuelle où ceux qui entraient dans la ville, ou qui en sortaient, faisaient leurs dévotions. À noter surtout un grand bâtiment, riche mais inachevé, que le P. de Vaux a interprété comme un palais dont le roi Omri, en 885 av. J.-C., interrompit la construction quand il décida de transférer sa capitale à Samarie (1 R 16, 23-24).
Le P. de Vaux est, en effet, arrivé à la conviction que le site fouillé par lui n’est autre que Tirsa, première capitale du royaume d’Israël, ainsi que l’avait déjà suggéré W. F. Albright. La situation géographique que nous avons décrite l’orientait vers l’est, comme il convenait aux origines du peuple israélite venu de l’orient. Mais on comprend que le désir de se tourner vers l’occident, dont témoignent le mariage de son fils Achab avec Jézabel (1 R 16, 31) et les relations étroites avec la Phénicie qui s’ensuivirent, aient déterminé l’abandon de Tirsa, du moins en tant que capitale, pour lui préférer Samarie, située à 15 km vers l’ouest et de communication plus facile avec la Méditerranée.
À ces trouvailles d’ordre architectural, il faut ajouter les riches trouvailles en objets de toutes sortes : silex, os, et surtout une abondante céramique, fournie notamment par une nécropole des époques Chalcolithique, Moyen Bronze ii et Récent Bronze. Les nécropoles de l’Ancien Bronze et du Fer ont malheureusement échappé aux recherches.
Prise par les Assyriens vers 723 av. J.-C. et démantelée, comme en témoigne une grande brèche ouverte dans le rempart au nord de la porte, Tel el-Fâr`ah devenu ville ouverte survécut quelque temps encore sous l’occupation assyrienne, mais dut cesser définitivement
Les fouilles de Tell el-Fâr’ah furent interrompues, et retardées, par celles que l’École dut mener au même moment à Khirbet Qumrân. Dès que la fin des hostilités permit d’atteindre la grotte où les Bédouins avaient découvert les premiers rouleaux manuscrits, on entreprit d’explorer soigneusement ce que les fouilleurs clandestins y avaient laissé. Puis, on comprit qu’il fallait inspecter le monticule voisin appelé Khirbet Qumrân, jusqu’alors négligé par les archéologues, et aussi la falaise voisine dont les nombreuses grottes pouvaient déceler d’autres trésors. La fouille de la grotte 1 et de la ruine fut entreprise par le Département des antiquités de Jordanie, dont le directeur était Mr Lankaster Harding, par le Palestine Archaeological Museum (ou Musée Rockefeller) dont le P. de Vaux était président des Trustees, et par l’École archéologique française dont il était directeur. À ce double titre, et parce que Mr Harding était le plus souvent retenu à Amman par les devoirs de sa charge, le P. de Vaux fut en fait le principal responsable des opérations. Les travaux commencèrent en 1951 par l’examen de la grotte 1. La fouille de la ruine prit quatre campagnes, de 1953 à 1956. Le site voisin et connexe de `Aïn Feshkha fut exploré en 1958. L’inspection minutieuse de la falaise et de ses grottes, pour laquelle on bénéficia du concours de l’American School of Oriental Research at Jerusalem, fut menée dès 1952 sur un front de 8 km du nord au sud. 230 grottes se révélèrent stériles, 40 livrèrent de la poterie et d’autres objets, la céramique de 26 d’entre elles étant identique à celle de la grotte 1. Les grottes qui fournirent des manuscrits, en quantités d’ailleurs fort variables, furent au nombre de 11, dont 6 dans les environs immédiats de Kh. Qumrân.
Le P. de Vaux a rendu compte des fouilles de Kh. Qumrân dans des rapports préliminaires de la RB 1949, 1953, 1954, 1956, 1959, puis dans les Schweich Lectures of the British Academy de 1959, qui parurent en un volume sous le titre L’archéologie et les manuscrits de la Mer Morte, London, 1961 (édition anglaise en 1973 : Archaeology and the Dead Sea Scrolls). Quant à la description archéologique des grottes et à l’édition des manuscrits qui y furent trouvés, elles furent réservées à une collection intitulée Discoveries in fhe Judaean Desert, publiée par l’Oxford University Press, dont le P. de Vaux fut l’éditeur en chef jusqu’à sa mort, remplacé ensuite par le P. Benoit. Commencée en 1955, cette collection a vu son volume V II paraître en 1982 et n’est pas encore achevée (NdR : pratiquement achevé en 2009).
Les importants résultats de cette exploration sont trop connus pour qu’il y ait lieu de les décrire ici. Notons seulement que la compétence et l’autorité du P. de Vaux ont donné aux nombreux problèmes que soulèvent ces fameux manuscrits une base archéologique et historique solide, dont les hypothèses de toutes sortes devraient toujours tenir compte.
Cette exploration de Qumràn s’accompagna, en 1952, d’une expédition dans le wady Murabba`ât, à une vingtaine de km au sud, où les Bédouins avaient découvert d’autres grottes à manuscrits, mais d’une époque différente, celle de la deuxième révolte juive, sous l’empereur Hadrien, en 132-135 de notre ère. On trouva là des fragments de la Bible et des documents divers, en hébreu, en araméen, en grec et en latin. Cette fouille et ses trouvailles ont été publiées dans le volume ii, 1961, de la collection Discoveries in the Judaean Desert, ainsi que dans un ouvrage du P. D. Barthélemy, alors membre de l’École et qui participa à la fouille : Les devanciers d’Aquila. Première publication intégrale du texte des fragments du Dodécapropheton trouvés dans Le désert de Juda…, Leiden, Brill, 1963.
Le P. de Vaux fut encore mêlé à des fouilles archéologiques à Jérusalem même, la première fois en 1956, la deuxième fois de 1961 à 1963 comme directeur associé à Dame Kathleen M. Kenyon, mais ces fouilles qui se firent toutes deux au sud de l’esplanade du Temple, furent chaque fois interrompues par des empêchements d’ordre politique.
Ces fouilles importantes ne suffisaient évidemment pas à absorber les forces de l’École Biblique et d’autres activités archéologiques se poursuivirent parallèlement.
En 1950, une grotte avait été découverte par hasard dans le terrain des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, près de Béthanie. Elle était presque comblée de terre, mais une croix peinte près de son plafond invitait à une investigation. Après son déblaiement par le P. de Vaux, il apparut que ses parois étaient couvertes d’inscriptions gravées ou peintes, ainsi que de nombreuses croix. Le P. Benoît, assisté du P. Boismard, déchiffra ces inscriptions et les publia dans la RB 1951, 20051. Ce sont des noms propres et des proscynèmes en grec et en latin, voire en syriaque et en arabe, que des pèlerins allant de Jérusalem à Béthanie, ou en revenant, y auront écrits pour commémorer leur visite. Cette vénération, qui semble s’étendre du IVe au VIIe siècle de notre ère est intéressante, mais son objet précis reste obscur.
Reprenant son grand ouvrage sur Jérusalem, dont nous avons mentionné plus haut la partie consacrée à la Ville chrétienne, le P. Vincent l’acheva en publiant, assisté du P. A.-M. Stève comme dessinateur : Jérusalem de l’Ancien Testament. I. Archéologie de la Ville. – II. Archéologie du Temple et III. Évolution historique de la Ville. 2 vol. de texte, 1 vol. de planches. Paris, Gabalda, 1954 et 1956. Le premier volume traite des remparts, des forteresses Acra et Antonia, des palais, des installations hydrauliques, des nécropoles ; tandis que le second volume est consacré essentiellement au Temple et s’achève par une synthèse de tout l’ouvrage.
Depuis l’accord enfin conclu, en 1959, pour la restauration d’ensemble de la basilique du Saint-Sépulcre, le P. Charles Coüasnon, architecte diplômé par le gouvernement français, et intégré à l’École pour participer aux fouilles du P. de Vaux, s’est vu confier par la Custodie franciscaine de Terre Sainte la charge de diriger les travaux pour le compte de la communauté latine. Il s’y est employé avec un zèle infatigable jusqu’à sa mort, en 1976, joignant autant que possible aux restaurations architecturales les observations archéologiques. II a résumé celles-ci dans les Schweich Lectures de la British Academy 1972, parues en 1974 sous le titre : The Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem.
En 1633, le P. Prignaud, assisté de quelques autres jeunes membres de l’École, a mené au Khan Saliba, près de la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, un sondage qui, sans pouvoir dégager tout le monument, y a révélé quelques pièces pavées en mosaïque avec l’inscription d’un “prêtre et higoumène Paul” (RB 1963, 243-54). Il s’agit sans doute d’une installation monastique destinée à héberger des pèlerins. Construit vers le début du vu siècle, ce “khan” chrétien a souffert au début du VIIe siècle (incursion de Chosroès ?) et a été violemment détruit au VIIIe siècle. Le docteur J. T. Milik a proposé d’y reconnaître, d’après un texte du moine Épiphane, “l’église dans laquelle Adam, s’étant assis, pleurait devant le Paradis”.
Tout en explorant et fouillant par elle-même, l’École archéologique française n’a jamais cessé de s’intéresser, comme par le passé, aux fouilles pratiquées par d’autres institutions. Depuis 1954, une « Chronique archéologique » a été inaugurée dans la Revue Biblique, qui rend compte périodiquement de ces fouilles en donnant la parole aux archéologues eux-mêmes, dont les rapports écrits par eux et accompagnés d’illustrations présentent leurs derniers travaux.
Atteint en février 1971 d’un mal qui devait l’emporter en septembre de la même année, le P. de Vaux s’est soucié de relancer l’activité des fouilles en passant la main à de plus jeunes. L’exploration de Qumrân étant achevée, et celle de Tell el-Fàr`ah ne pouvant être poursuivie à cause des circonstances politiques, il porta son choix sur Tell Keisan et obtint l’autorisation d’y pratiquer des fouilles. Ce site est un beau tell se dressant au milieu d’une vaste plaine, à d’intéressantes informations sur les relations culturelles entre Phénicie et Palestine, entre Chypre ou Crète et le continent. Son nom ancien est ignoré, mais les anciennes prospections anglaises attestaient une occupation qui commence au Bronze ancien et se prolonge jusqu’aux croisades.
La fouille, dirigée d’abord par le P. Jean Prignaud, puis par l’abbé Jacques Briend et enfin par le P. J.-B. Humbert assisté du Fr. E. Nodet, a déjà duré huit campagnes, de 1971 à 1980, et procuré d’importants résultats qui ont été consignés dans un gros volume : Tell Keisan (1971- 1976), une cité phénicienne en Galilée, Fribourg/Suisse, Éditions universitaires ; Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht ; Paris, Gabalda, 1980. Au-dessous d’une église byzantine trouvée en surface, on a déjà atteint les niveaux hellénistique, perse, Fer II, Fer I et Bronze récent.
Le P. J.-B. Humbert et l’abbé A. Desreumaux, assistés du P. J.-M. de Tarragon ont aussi entrepris une fouille en Transjordanie, à Khirbet es-Samra, à 50 km au nord-est de Amman, sur un site déjà remarqué par le P. Savignac en 1924 (RB 1925, 115-131). Six campagnes ont eu lieu (1978-1986). Le projet visait à donner un contexte archéologique au cimetière syro-palestinien déjà connu. Huit églises pavées de mosaïques ont déjà été mises au jour, une forteresse romaine et une enceinte.
Le christianisme a fleuri à Samra tardivement sous les Omeyyades (VIIe-VIIIe s.). L’exploration a fourni près de 800 stèles funéraires dont plus d’une centaine sont inscrites en grec et syro-palestinien. Des sondages ont montré que le site avait été fondé au Ier siècle après J.-C. par les Nabatéens et que l’apogée économique se situe au IIIe siècle de notre ère. De plus, la voie romaine Nova Trajana a été explorée sur plus de 40 km, vers la frontière syrienne ; plus de 150 inscriptions ont été copiées dont un tiers sont inédites.
Cependant l’école a désiré ouvrir un nouveau chantier en Transjordanie concernant la période du Fer. Le projet de retrouver les traces archéologiques des poussées araméennes dans le nord de la Jordanie était séduisant. Le site de el-Fedein a été choisi dans la périphérie de Mafraq. Une campagne a eu lieu en 1986 sous la direction de J.-B. Humbert. II n’a pas été prouvé encore que la grande enceinte cyclopéenne (50 x 70 m) appartenait à la période du Fer. L’enceinte avait abrité d’abord un monastère monophysite dont on a retrouvé l’église ; puis une forteresse omeyyade dont le riche mobilier rappelle ceux des palais omeyyades connus. L’installation du Fer a été reconnue à quelques dizaines de mètres, marquée par une céramique lustrée des IXe-VIIIe siècles ( ?) avant J.-C. D’autres campagnes sont prévues.
Consacrés d’abord aux activités archéologiques de l’École archéologique française de Jérusalem depuis près de cent ans, cette chronique serait incomplète si elle ne faisait pas aussi mention des travaux menés par d’autres archéologues français durant la même période.
Nous avons déjà parlé du Père J. Germer-Durand, épigraphiste distingué, qui a publié de nombreuses inscriptions grecques dans la Revue Biblique. Le même auteur a rendu compte dans la RB 1914, 71-94 ; 222-46, des fouilles que ses confrères assomptionnistes et lui-même ont menées durant de longues années, de 1889 à 1912, dans le vaste terrain qu’ils ont acquis sur la pente orientale de la colline occidentale de Jérusalem, descendant vers le Tyropoeon. II y discerne les occupations suivantes : un cimetière à hypogées antérieur au temps d’Hérode ; une riche habitation juive avec installations agricoles, datée du Ier siècle de notre ère ; une église byzantine du Ve siècle recouvrant en son centre une grotte profonde ; une habitation musulmane. De la grotte elle-même il trace ainsi l’évolution ; un tombeau, transformé en grotte par creusement qui a doublé sa profondeur, devenue ensuite l’objet d’une vénération chrétienne (des croix peintes ou gravées sur les parois), puis recouverte d’un nouvel enduit, et utilisée comme citerne. Il n’est pas douteux qu’on a là la grotte où les pèlerins chrétiens ont vénéré, depuis le haut Moyen Âge, les pleurs de saint Pierre après son reniement : « Saint Pierre in Gallicantu ». Mais le P. Germer-Durand a cru pouvoir remonter plus haut. D’une analyse des textes d’anciens pèlerins et d’une étude des objets trouvés, entre autres de nombreux poids et mesures juifs ainsi que d’un linteau avec inscription hébraïque portant le mot « Qorban », il a prétendu conclure que l’habitation juive du Ier siècle n’était autre que la maison du grand prêtre Caïphe. La grotte serait la prison où Jésus aurait passé la nuit du jeudi au vendredi saint, et on pourrait voir encore auprès d’elle une salle de flagellation. Conclusions qui ont donné lieu à des controverses, voir les articles du P. Vincent dans la RB 1927, 633-6 ; 1929, 155-9 ; 1930, 225-56, et les remarques du P. Barrois sur les prétendus étalons de poids et mesures, RB 1931, 210.
Tout en se défendant d’être un archéologue, le Père Prosper Viaud, gardien du couvent franciscain de l’Annonciation à Nazareth, a mené dans ce couvent, à partir de 1890 et surtout en 1907-1909, des fouilles fructueuses dont il a publié les résultats dans un ouvrage intitulé : Nazareth et ses deux églises de l’Annonciation et de Saint-Joseph d’après les fouilles récentes, Paris, Picard, 1910. II a redécouvert la cathédrale de l’époque croisée, une église de 75 m de long, à trois absides, dont les murs s’élèvent encore à la hauteur de près de trois mètres. Il a trouvé aussi, enfouis sous une salle du couvent, cinq chapiteaux historiés de la fin du XIIe siècle, admirablement conservés. Il a dégagé enfin, au nord de cette cathédrale, une autre église croisée qui servait sans doute au culte paroissial. On sait que depuis lors, en 1955-66, des fouilles dirigées par le P. Bagatti, o.f.m., ont mis en valeur des vestiges plus anciens qui remontent aux époques byzantine, pré-byzantine et évangélique. Une nouvelle basilique a été érigée, qui garde en grande partie le plan de la cathédrale médiévale et préserve les restes des époques plus anciennes.
Vers le sommet du mont des Oliviers se trouve un terrain où la tradition place le souvenir de l’Éléona, église construite par Hélène, mère de Constantin le Grand, sur une grotte où Jésus aurait enseigné, soit le discours eschatologique (Mc 13 et par.), soit le Pater. La princesse de la Tour d’Auvergne avait acheté ce terrain pour le compte de la France, et les Pères Blancs, “Missionnaires d’Afrique” du cardinal Lavigerie, s’en étaient vu confier la garde. Église et grotte avaient disparu. Les Pères Jean-Louis Féderlin et Léon Cré les ont retrouvées par des fouilles menées en 1910-11 (cf. Léon Cré, Oriens Christianus, 1911, 119- 34) ; et le P. Vincent, qui a suivi de près les travaux, en a publié une description et une interprétation dans la RB 191I, 219-65. L’édifice a été complètement détruit, mais les fouilles ont pu en retracer le plan : une basilique à une abside et trois nefs, longue d’une trentaine de mètres, précédée d’un atrium recouvrant une citerne et de propylées. On a retrouvé des débris architecturaux, des pavements en mosaïque, et surtout la grotte vénérée, aménagée en crypte sous le chœur et en partie conservée.
En 1913-14, le capitaine Raymond Weill a fouillé un terrain acheté par le baron Edmond de Rothschild sur la pente orientale de l’Ophel, à quelque 200 m au sud de la source Gihon. Voir son compte rendu : La Cité de David. Campagne 1913-1914, Paris, Geuthner, 1920 ; et les analyses du P. Vincent dans la RB 1921, 410-33 ; 541-69. On a repéré s’échelonnant parallèlement sur cette pente rapide plusieurs tombes, ainsi que des murs et murettes courant nord-sud, dont l’interprétation difficile devra être entièrement révisée à la lumière des nouvelles fouilles, récentes et actuelles, menées dans ces parages. À retenir surtout, au sommet, sur une terrasse rocheuse malheureusement ravagée par des carrières romaines, les restes probables et encore impressionnants d’anciens hypogées royaux, dont on sait par la Bible (Ne 3, 16) qu’ils se trouvaient dans cette région, et aussi d’une inscription grecque du Ier siècle de notre ère qui atteste la présence en ce lieu d’une “synagogue des Affranchis” (cf. Vincent, RB 1921, 247-77).
Au cours de cette première campagne, le capitaine Weill avait ouvert un chantier secondaire à la pointe sud de l’Ophel. Il en reprit l’exploration en 1923-24 (La Cité de David. II. Campagne de 1923-1924, Paris, Geuthner, 1947) et crut y retrouver un « château de la pointe » et un « donjon » cananéens, dont la reconstitution qu’il en a tentée est entièrement caduque (cf. Vincent, RB 1949, 614-17). À retenir surtout de cette deuxième campagne de fouilles la mise au jour d’une dérivation du canal qui amenait l’eau de la source Gihon, dérivation qui conduisit l’eau vers une grande piscine (l’actuelle Birket el-Hamra), et qui servit plus tard, recreusé, à évacuer en sens contraire les eaux de la piscine d’Ezéchias vers le Cédron.
Teleilât Ghassoul est le nom de trois tertres peu élevés (en un endroit, 5, 50 m du sommet au sable vierge) situés à environ 5 km et demi à l’orient du Jourdain et 5 km au nord de la mer Morte. Le Père Alexis Mallon, s. j., alors recteur de l’Institut biblique pontifical de Jérusalem, annexe de celui de Rome, y a pratiqué des fouilles en 1929-32. En dépit de quelques mésaventures (galets gravés qui se sont avérés être des faux) ou méprises (identification de ce site et de sa région avec Sodome et la Pentapole, théorie qui a été depuis controversée et abandonnée ; cf. RB 1931, 388-400 ; 1932, 489-514), cette exploration a obtenu des résultats intéressants (Teleilât Ghassut, I. Rome, 1934). Elle a mis en valeur une culture d’époque néolithique et chalcolithique (environ 4000-3500 av. J.-C.) assez typique pour être devenue un terme de référence archéologique sous le nom de “ghassoulien”. Ses quatre niveaux supérieurs, atteints par la première campagne, sont caractérisés par le “cornet”, la décoration peinte au pastel, le racloir en éventail, le ciseau, et des peintures murales étranges, fort abîmées et d’interprétation difficile. Bien que cela dépasse le cadre de cet article, signalons que, après la mort du P. Mallon en 1934, la fouille a été continuée par des membres non français de l’Institut biblique pontifical, le P. Robert Köppel jusqu’en 1938, le P. Robert North en 1959-60, et enfin reprise à partir de 1967 par le docteur Basil Hennessy, de la British School of Archaeology at Jerusalem. Ce dernier archéologue a atteint cinq niveaux plus profonds et constaté six anciens tremblements de terre qui ont grandement perturbé les couches, ce qui explique que les fouilles antérieures aient été fort embarrassées pour établir une stratification cohérente.
L’industrie lithique de la fouille de Teleilât Ghassoul fut étudiée par René Neuville. Âgé de vingt-sept ans, ce jeune savant donnait déjà des preuves de sa compétence. Attaché au Consulat général de France à Jérusalem, d’abord en qualité de chancelier puis de vice-consul de 1926 à 1937, et ensuite comme consul général de 1946 à 1952, date de sa mort, René Neuville sut joindre à ses obligations de diplomate une carrière très féconde de préhistorien. Outre des explorations de surface, il fouilla dans les monts de Judée, au sud de Bethléem, de nombreuses grottes, dont celle de Oumm Qatafa dans le wady Khareitun (1928, 1932 et 1949) est sans doute la plus connue. Les résultats de ses recherches ont fait l’objet de nombreux articles. Un premier essai de synthèse sur “la préhistoire de Palestine” a paru dans la RB 1934, 237-59. Peu avant sa mort, un ouvrage intitulé Le Paléolithique et le Mésolithique du désert de Judée, Paris, Masson, 1951, a présenté la somme de ses travaux et de ses conclusions. Par ses recherches assidues et ses pénétrantes intuitions, René Neuville a été l’un des pionniers qui ont fait sortir de l’enfance et grandement progresser la connaissance de la préhistoire palestinienne.
Suivant un ordre chronologique, il faut mentionner ici les fouilles qui furent pratiquées à partir de 1931, à Jérusalem, dans le couvent des Sœurs de Notre-Dame de Sion dit “Ecce Homo“, par la Mère Marie-Godelieve, supérieure de cette institution, et plus tard par la Mère Marie-Aline de Sion, qui lui succéda. Cette dernière a publié les résultats et l’interprétation de ces recherches dans un ouvrage intitulé La forteresse Antonia à Jérusalem et la question du Prétoire, Jérusalem, Imprimerie franciscaine, 1955. De son côté, le P. Vincent, qui suivit de très près ces fouilles et en guida l’interprétation, leur a consacré plusieurs articles de la RB : 1933, 83-113 ; 1937, 563-70 ; 1952, 513-30 ; 1954, 87-107. La question traitée est double : la structure de la forteresse Antonia et son identification avec le Prétoire où Jésus fut jugé par Pilate. Tout en rendant hommage à l’ardeur des travaux de dégagement et à l’ingéniosité de l’interprétation, je dois dire que la reconstitution archéologique proposée me parait sans fondement et que le Prétoire de Pilate était alors selon moi l’ancien palais d’Hérode le Grand, dans la région de la citadelle de la ville actuelle. Je m’en suis expliqué dans deux articles auxquels je me permets de renvoyer : Prétoire, Lithostrôton et Gabbatha, RB 1952, 531-50 ; L’Antonia d’Hérode le Grand et le Forum oriental d’Aelia Capitolina, HTR 64, 1971, 135-67.
En 1933, Mme Judith Marquet-Krause a entrepris des fouilles, patronnées par le baron Edmond de Rothschild, sur le site biblique de ’Aï, aujourd’hui et-Tell, qui domine à l’ouest le village de Deir Diwân. Sa mort prématurée en 1935 ne lui a malheureusement pas permis de mener plus de trois campagnes, mais qui furent fructueuses. L’occupation s’est avérée avoir duré pendant tout le Bronze Ancien, s’être interrompue aux Bronze Moyen et Récent, et avoir repris au Fer avec abandon définitif vers l’an 1000 av. J.-C. D’importantes structures ont été mises au jour : trois lignes d’un rempart massif, un sanctuaire et un “palais”. Des rapports préliminaires ont rendu compte de ces trouvailles, et le P. Vincent en offrait une première synthèse dans la RB 1937, 231-66. Le décès de l’exploratrice ne lui a pas laissé le temps de confirmer ou de corriger ses conclusions par une exploration plus poussée. De fait, on peut voir par la recension du P. de Vaux parue dans la RB 1950, 621-24, que plusieurs des vues de l’exploratrice étaient à réviser. II rendait compte d’un volume : Les fouilles de ’Ay (Et-Tell) 1933-1935. La résurrection d’une grande cité biblique, Paris, Geuthner, 1949, où des mains pieuses avaient rassemblé avec plus de dévouement que de compétence les documents et les matériaux laissés par l’archéologue défunte. Il est certain que celle-ci aurait mis au point bien des choses s’il lui avait été donné de poursuivre ses travaux. Ce qu’elle a trouvé était riche et prometteur, mais la fouille devait être reprise et étendue. Elle l’a été à partir de 1964 sous la direction du Professeur Joseph A. Callaway, auquel cet ouvrage est dédié en hommage, et on sait avec quel succès.
Le domaine de l’église Sainte-Anne, à Jérusalem, recouvre la piscine de Béthesda, près de l’antique porte Probatique, dont Jn 5, 2 dit qu’elle avait cinq portiques. Dès 1873, lorsque l’architecte C. Mauss entreprit la restauration de l’église médiévale que la Turquie venait de céder à la France, il eut la bonne fortune de découvrir un petit bassin qui appartenait à l’antique piscine. À partir de 1878, les Pères Blancs, devenus gardiens de ce sanctuaire français, s’appliquèrent par de nombreux sondages, menés en particulier par le Père L. Cré, à retrouver les dimensions originales de la piscine. Il s’agit en fait de deux grands bassins creusés dans le roc, juxtaposés du nord au sud et séparés par une sorte de digue est-ouest. L’ensemble a une forme trapézoïdale, et les dimensions sont de 62 et 80 m sur les côtés nord et sud, de 100 et 110 m sur les côtés ouest et est. L’École biblique s’était, bien entendu, intéressée à ces découvertes, et des éléments d’architecture retrouvés le P. Vincent avait conclu que l’église byzantine commémorant le miracle évangélique utilisait la digue médiane pour porter sa nef centrale, tandis que ses nefs latérales surplombaient la partie sud du bassin nord et la partie nord du bassin sud. L’ensemble de ces trouvailles et de ces conclusions avait été consigné dans l’ouvrage d’un Père Blanc hollandais, N. van der Vliet, “Sainte Marie où elle est née” et la piscine probatique, Jérusalem, Imprimerie franciscaine; Paris, Gabalda, 1938.
Or, à partir de 1956, de nouvelles fouilles ont été entreprises par les Pères Blancs, en particulier par les PP. Blondeel et Pochet, en étroite collaboration avec l’École biblique, représentée par les PP. de Vaux et Rousée. Les résultats acquis par les recherches antérieures ont été en partie confirmés, en partie corrigés et complétés. La date probable des grands bassins a été fixée aux environs de l’an 200 av. J.-C. ; ils seraient l’œuvre du grand prêtre Simon dont parle l’Ecclésiastique 50, 3 (mais cette date est actuellement en cours de révision). Ils auront cessé de servir quand Hérode le Grand a creusé la Birket Israïl, située un peu au sud, le long du mur nord de l’esplanade du Temple. Il est apparu que les “portiques” dont parle l’Évangile n’ont jamais existé. En tout cas on n’a trouvé aucune colonne qui les prouve ; celles qu’ont dégagées les fouilles, anciennes et récentes, appartenaient à l’église byzantine. Celle-ci présentait bien le plan dont le P. Vincent avait eu l’intuition, avec cette nuance que l’abside se trouvait à l’extrémité orientale, comme il est normal, et non à l’occident comme l’avait imaginé le P. Vincent. On a retrouvé les grandes arches qui, plongeant jusqu’au fond rocheux du bassin sud, supportaient la nef latérale sud de l’église. Mais la découverte la plus importante fut que la moitié orientale de cette église, à l’est des deux grands bassins, recouvrait – et oblitérait – un ancien sanctuaire de guérison. Garanti pour les IIe et IIIe siècles par la poterie, les monnaies, et des ex-voto qui en font un Asclépieion, ce lieu de guérison existait déjà au Ier siècle (attestation céramique et numismatique), sans qu’on puisse définir alors son appartenance religieuse. En tout cas, avec ses petits bassins-baignoires et ses galeries (d’incubation ?), il offre à l’épisode évangélique un contexte bien meilleur que les deux grands bassins profonds de quelque treize mètres, où les malades auraient dû plonger pour être guéris ! En attendant une publication définitive qui se prépare, on peut se référer à quelques présentations préliminaires : RB 1957, 226-28 ; 1962, 107-9 ; J. M. Rousée, L’église Sainte-Marie de la Probatique. Chronologie des sanctuaires à Sainte-Anne de Jérusalem d’après les fouilles récentes, dans les Atti del VI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana. Ravenne 23-30 settembre 1962, Citta del Vaticano, 1965, 168-176 ; P. Benoît, Découvertes archéologiques autour de la piscine de Béthesda, dans Jerusalem Through the Ages, Jerusalem, The Israel Exploration Society, 1968, pp. 48-57 ; A. Duprez, Jésus et les dieux guérisseurs. À propos de Jean, V (Cahiers de la RB n° 12), Paris, Gabalda, 1970.